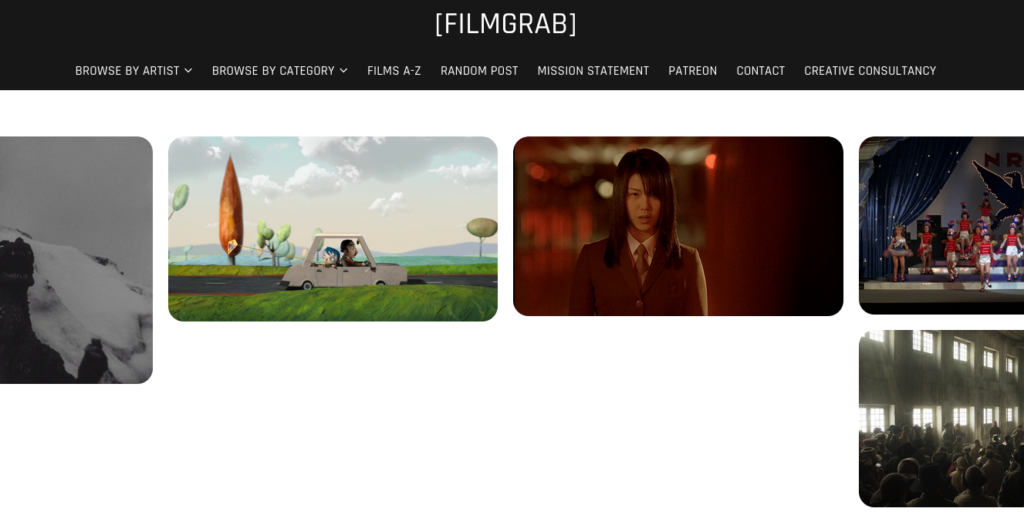Suite à des premières expériences comme chef opérateur sur des films d’écoles et des courts métrages, Thomas Rames a décidé de se lancer dans la court des grands directement après ses études au SATIS.
Bonjour Thomas, en quelle année es-tu sorti du SATIS ? En quelle option ?
Je suis sorti du Satis en 2009, option image, en même temps que l’arrivée des tournages numériques en HD (haute définition). On a vécu cette phase de transition entre la pellicule et le numérique. Au Satis, l’équipe pédagogique comprenait que les choses changeaient, mais ils n’avaient pas les moyens de mettre en place les nouveaux outils. Très vite, on s’est retrouvé à trouver des solutions par nous-mêmes, à travailler la HD sur nos projets personnels, en apprenant sur le tas, en faisant des petits courts métrages, avec les kits mini 35 et autres astuces.
Où avais-tu étudié avant le SATIS ?
J’ai suivi un IUT Service et réseau de communication. J’avais présenté à la sortie du bac des BTS Audiovisuel, mais sur les conseils de mon père, j’ai choisi une formation plus généraliste, pour me laisser des possibilités au cas où j’aurais eu envie de changer de voie. C’était très orienté vers l’informatique, la programmation, et ce sont des connaissances qui m’ont aidé à comprendre le fonctionnement des caméras numériques, de comprendre l’information numérique.

Tu es actuellement chef opérateur pour des clips, du court et du long métrage. Es-tu passé par le chemin habituel : loueur, puis assistant caméra puis chef opérateur ? Peux-tu nous parler de ton parcours professionnel ?
Quand j’ai présenté mon mémoire de fin d’études, Isabelle Singer (responsable pédagogique de l’option prise de vue) m’a vraiment encouragé à être chef opérateur, à aller chercher des opportunités à Paris. C’était une envie que j’avais dès les études, où j’étais chef opérateur sur les projets des copains. J’ai donc suivi son conseil, et je n’ai pas pris le chemin classique d’assistant : troisième, second, premier et finalement, chef opérateur. Même si très rapidement, alors que je pensais avoir atteint le Graal (être chef opérateur), j’ai pris conscience que j’avais très peu de connaissances. J’ai eu le besoin d’aller travailler comme assistant caméra et électro sur des tournages, pour me renseigner, apprendre mon métier auprès de mes pairs.
J’ai eu un déclic sur un film danois qui se tournait en Rhône-Alpes. Le chef opérateur était Magnus Joenck, très réputé au Danemark, une sorte de Darius Khondji danois. Je voulais absolument travailler avec lui, alors j’ai appelé la production et comme ça se tournait dans ma région natale, j’ai pu intégrer l’équipe caméra. J’ai vraiment appris à ses côtés, il avait vraiment envie de partager son expérience. On a beaucoup parlé, il m’a expliqué beaucoup de choses, ça a été très formateur. À ce moment-là, j’ai compris le rapport du chef opérateur avec le réalisateur et la mise en scène. C’est une rencontre capitale, qui m’a ouvert les yeux. Il prônait un naturalisme assez travaillé ; il éclairait peu, utilisait la lumière naturelle, filmait caméra à l’épaule. C’était une esthétique propre à cette époque, il y a dix ans, le nouveau dogme danois avec les premiers films de Nicolas Winding Refn, etc. Ça m’a permis de décomplexer l’outil caméra, la lumière. De me dire qu’en fait, il faut juste se servir de ce qui existe, et la caméra est juste un outil qui permet de capter des choses, que ce n’est pas si complexe que ça.
Comment un chef op arrive sur un projet : par le réalisateur ? Le producteur ? Un « casting » de chef opérateur ?
C’est très variable. La plupart du temps c’est par le réalisateur, qui me connait parce qu’on a fait des courts métrages ensemble. Si ce n’est pas le cas, il est allé voir mon travail, ça lui a plu et il m’a contacté. Plus rarement, par l’intermédiaire de sociétés de production. Parfois, c’est comme « un casting ». Le réalisateur regarde le travail de plusieurs opérateurs, il fait une présélection, les rencontre et il se décide. Mais je n’aborde pas ça comme une compétition, la plupart du temps je ne sais même pas quels sont les autres opérateurs contactés. Je crois que c’est une question de feeling avec le réalisateur. En théorie, n’importe quel opérateur confirmé est capable de faire ce qu’on lui demande. La différence se fait sur la compréhension de l’un et de l’autre, et si le chef opérateur arrive à bien comprendre l’univers du réalisateur. Parce qu’au final c’est ça notre métier, c’est de retranscrire l’univers ou les envies d’un/e réalisateur/trice. Ce n’est pas de refaire la petite recette magique qu’on ressort à tous les films.
Comment prépares-tu un film ?
J’aime beaucoup la prépa. En général, je me bats pour en avoir le plus possible. La production ne paye quasiment jamais mon vrai temps de prépa (entre 4 et 7 semaines selon les films). En général ils budgétisent 1 à 2 semaines. Je suis toujours obligé de négocier pour en avoir plus en expliquant que je suis tout le temps là, que je suis au bureau avec le réalisateur. Que le travail se fait à ce moment-là, et que le tournage n’en est que l’exécution.
J’aime passer du temps avec le réalisateur, à regarder des films, à parler de cinéma. Pas forcément du film, mais des films en général, pour voir ce qu’il aime ou pas, et travailler comme un entonnoir. Je propose des idées, je me rends compte de ce qu’il aime ou pas, et on trouve un juste milieu qui correspond au film.
Rapidement, je demande aussi au réalisateur : où veux-tu placer le spectateur dans le film ? C’est très important, parce qu’en fonction de l’endroit où tu veux le placer, les émotions qu’il va ressentir vont être complètement différentes. Ça passe par la position de la caméra, par les cadres. C’est une réflexion que j’ai tirée de mon mémoire de fin d’étude, que j’avais fait sur l’esthétique visuelle des films d’horreur. J’ai orienté mes recherches sur la manière d’effrayer le spectateur, par le cadrage notamment. Mais une fois que tu as pigé, tu peux le dérouler pour tous les genres et toutes les émotions.
Comment gères-tu les différentes ambiances d’un film ?
Je travaille par référence, avec des photos, des screenshots de film, des peintures, qu’on glane sur internet ou sur quelques sites spécialisés comme Shotdeck ou Filmgrab. Les images y sont bien classées, avec des mots clés, qui renvoient à d’autres images, du coup on cherche un truc au début et on trouve un autre film… On s’y perd et c’est vraiment bien ! Il y a tellement de films, on ne peut pas se rappeler de tout. C’est génial de pouvoir se balader dans ces références, et faire un patchwork pour avoir une idée globale du film. Après je le montre au réalisateur, et il me dit ce qui lui plaît.
Quand tu lis le scénario, tu imagines comment pourrait être le film et c’est difficile d’imaginer la vision du réalisateur. Parfois, tu peux complètement te gourer, par exemple en imaginant un film avec des cadres posés, du travelling… Alors que le réalisateur voit en fait le truc tout à la caméra épaule, et du coup tu dois revoir ta vision du film, c’est très intéressant. Tu apprends à connaître le réalisateur, et le temps permet d’affiner tes choix et ta réflexion. Petit à petit, c’est comme si le film s’ouvrait à toi et tu comprends de plus en plus dans quel univers tu vas évoluer.
Willy 1er est ton premier long métrage en tant que chef opérateur, et aussi le premier long métrage d’un quatuor de réalisateurs (Ludovic & Zoran Boukherma, Marielle Gautier et Hugo P. Thomas), ce qui n’est pas courant. Comment on travaille avec 4 réals ?
Ils étaient très jeunes, sortaient de l’école de la Cité (école de cinéma créée par Luc Besson) et avaient vraiment la pression. Moi c’était mon premier long métrage, et j’avais envie de bien faire. C’était une esthétique brute, crue, on l’a tourné comme un documentaire, avec une toute petite équipe. J’avais un assistant caméra et un électro. Il n’y avait pas de HMC, pas de déco, deux sondiers, deux régisseurs, deux assistants mise en scène et c’était tout ! On a tourné pendant plus de deux mois et demi. Et quasiment qu’avec des acteurs non professionnels, sauf Noémie Lvovsky, qui a vraiment su s’adapter aux jeux des comédiens amateurs. C’était un exercice très particulier.
Quand tu travailles avec quatre réalisateurs, tu as quatre cerveaux ! Qui pensent tout ensemble, prennent toutes leurs décisions… ensemble. Il n’y en avait pas un plus orienté sur la direction d’acteur, et un autre plus sur la technique. C’était vraiment tout le temps : prise de décisions à quatre. Quand ils réfléchissaient à quelque chose, ça prenait du temps. Et quand ils tombaient d’accord, c’était très difficile pour moi de proposer quelque chose d’autre, parce que je savais que derrière il y aurait encore 15 – 20 minutes de discussion… Ce film m’a surtout appris la diplomatie en tournage. Une des choses les plus importantes quand tu bosses en équipe. Être diplomate, ne pas être buté, ne pas être persuadé d’avoir raison et faire le forcing pour imposer ses idées. Des fois, il faut faire des compromis pour le bien du film. Si tu forces trop, ça ne va pas bien se passer, que ce soit avec les réalisateurs ou avec les équipes. Et ça peut créer des disparités dans le film en lui-même. Pour moi, un film est fait de compromis, d’écoute entre les gens, c’est un travail collectif et non individuel. Et ce film m’a vraiment appris ça.
Dans « Les Parfums », tu filmes deux grands acteurs, qui sont aussi des stars : Emmanuelle Devos et Grégory Montel. Comment on collabore avec des vedettes ?
Il faut faire attention et apprendre à connaître leur personnalité. En général, on sait bien en amont si un acteur ou une actrice a des exigences particulières et fait attention à la manière dont il/elle est filmée, ou s’il/elle est plutôt cool sur cet aspect-là. Les deux étaient adorables, que se soit Grégory Montel ou Emmanuelle Devos. Cependant, et c’est ennuyant de dire cela, mais lorsqu’on filme un visage de femme, il faut faire attention. Ça ne devrait pas être ainsi, mais il y a ce culte de la jeunesse dans la représentation des femmes, qui doivent toujours apparaître jeunes et belles. Ce culte existe beaucoup moins chez les hommes mais il est quand même difficile pour un acteur ou une actrice de se voir vieillir à l’écran. C’est compréhensible mais la société et les médias s’acharnent beaucoup plus sur une recherche de jeunesse éternelle chez les femmes et ce n’est pas normal. C’est donc souvent les actrices qu’il faut rendre douces, éclairer avec une lumière indirecte, faire attention aux rides… De toute façon, les comédiens expérimentés voient ce qu’ils se passent sur le plateau, et comprennent ce que tu fais. Par exemple, juste le fait de sortir un petit poly pour déboucher le regard, ils comprennent rapidement que tu prends soin d’eux. Ça les met en confiance. Ça crée un rapport de confiance avec l’opérateur qui permet de leur parler plus librement. Souvent, les acteurs ont besoin d’être rassurés par le chef opérateur, car c’est lui qui a la responsabilité de leur image de ce qui va être vu par des milliers de personnes, et c’est très angoissant pour un acteur ou une actrice.
Le chef opérateur, c’est aussi un chef d’équipe. Comment tu constitues ton équipe ?
J’essaie de choisir des gens qui sont gentils. (rires) Pour moi, c’est une des qualités principales. Quand tu es sur un plateau, il y a tellement de stress, ça va tellement vite, il faut travailler avec des gens qui gardent leur sang-froid, qui ne s’engueulent pas avec d’autres corps de métiers, qui ne sont pas caractériels… Il faut des gens agréables et doux. C’est une qualité primordiale, plus que d’être un grand technicien. Ce n’est pas le plus compliqué d’être un bon technicien, le plus compliqué est de savoir s’adapter au tournage sur lequel on est. Savoir comment bien fonctionner en équipe. C’est ce qui fait un bon assistant caméra ou un bon électro ou machino. En plus de bien savoir travailler, évidemment.
Tu travailles aussi sur des clips. Est-ce que c’est un espace plus libre d’expérimentation ?
Complètement. Mais étonnamment, ce n’est pas sur les clips à gros budget que j’expérimente le plus. Ce genre de clips, avec des gros artistes mainstream, c’est très cadré et ça ressemble beaucoup à une pub. La DA (direction artistique) est définie bien en amont, et le chef op intervient un peu comme un exécutant. Ce n’est pas le plus excitant. Au contraire, quand le label de musique n’a pas d’argent, tu dois t’adapter, trouver des solutions, et c’est là où tu peux être complètement créatif. Parce que le label de musique, de toute façon, ne te donne presque rien ! Donc il te dit : « Faites ce que vous voulez ! » (rires) J’ai un coup de cœur pour la caméra P2 de Panasonic, sortie en 2006. Elle a un capteur tri-CCD incroyable, une restitution des couleurs magnifiques, on dirait presque de la pellicule. Dès qu’y’a un petit clip sans budget, je l’utilise parce que le résultat est vraiment bluffant.
À ces propos, quelle est ta configuration de caméra préférée ?
Pour un projet de fiction, j’aurai plutôt tendance à vouloir tourner en Alexa. C’est une caméra pratique, que tout le monde connait. Je sais comment son capteur fonctionne, comment je peux l’exposer, les rendus que je peux avoir. J’aime jouer avec les sensibilités de cette caméra, aller tirer les sensibilités très fort. On ne se pose pas la question de comment elle fonctionne. Y’a un bouton rec, tu prends la caméra, elle tient sur ton épaule et c’est parti. Contrairement à une Red, où il y a beaucoup d’informations à prendre en compte.
Mais encore une fois, ça reste un outil. Une fois que tu connais l’outil, tu peux arriver à sortir à peu près les mêmes images en Venice, Alexa ou Red. Ce qui change c’est les optiques. C’est la partie qui m’amuse le plus : choisir les optiques qui sont adaptées au projet. Pour le coup, il y a vraiment un choix très large, allant des optiques neuves aux optiques vintage, sphériques, anamorphiques, des focales plus courtes, des zooms… Tout un patchwork de possibilités, et c’est le plus intéressant.
Comment abordes-tu l’étalonnage ?
Forcément ça dépend du projet et du budget. Dans l’idéal, je fais des essais pendant la prépa, avec différentes caméras, différentes optiques, différents filtres, je combine le tout avec les décors et les costumes, idéalement les comédiens maquillés, pour vraiment se rendre compte de l’image du film. On utilise ensuite ces essais pour générer une ou plusieurs LUTs de travail qu’on va utiliser pour le tournage et le montage, afin que le réalisateur voit une image correcte sur le plateau et dans la salle de montage. C’est nouveau avec le numérique, mais tout le monde a accès aux rushes. Déjà en tournage, il y’a des moniteurs partout. Tout le monde a son moniteur : le réalisateur, la scripte, le HMC, le son… Quand les dailies sont mises en ligne avec les LUT appliquées, tout le monde a accès : la production, le distributeur, la chaîne… Donc il y a une vraie pression.
À l’époque de la pellicule, les dailies étaient projetés dans une salle de cinéma le soir après la journée de tournage avec l’équipe et c’est tout. De nos jours, tout le monde a accès à l’image et tout le monde veut voir l’image définitive dès le tournage. Et c’est terrible. Parce que tu as beau expliquer que ce n’est pas le résultat final, qu’il y a encore plein d’étapes, que l’étalonnage va amener beaucoup de choses… On est obligé de préparer en amont une LUT déjà assez marqué, flatteuse, et même si ce n’est pas l’image finale, au moins tout le monde le voit et se dit « OK c’est chouette ».
En général, deux semaines d’étalonnage par long-métrage me suffisent. Je bosse quasiment tout le temps avec Marine Lepoutre, une étalonneuse super. Je l’aime beaucoup, car elle ne va pas complètement dénaturer l’image et l’emmener dans une direction différente. Au contraire, elle va juste la magnifier et la rendre encore plus vivante. Évidemment elle rend le film raccord, mais surtout elle respecte le travail qu’on a fait.
Est-ce que tu tournes en RAW ?
Je ne vois pas d’intérêt à tourner en RAW, en tout cas pour les films que j’ai fait jusqu’à présent. Et ça me permet de faire un pas vers la production. En Prores, ça coûte moins cher en disque dur, en temps de backup. Ça fait partie de la diplomatie dont je parlais : si c’est quelque chose dont tu n’as pas absolument besoin, ne le fais pas et utilise cet argent pour autre chose. Le budget d’un film, ce sont des vases communicants : on enlève du budget ici pour en mettre là, etc. Si j’ai besoin pour le film d’une liste d’optiques chère, je vais faire un geste et alléger ma liste lumière ou je vais tourner en Prores au lieu de tourner en RAW. Ça me donne un argument de négociation.
La plupart des gens savent que les acteurs sont représentés par un agent, mais les techniciens peuvent aussi en avoir un. Tu es représenté par Cinélite. Concrètement, qu’est-ce que ça change d’avoir un agent ?
Techniquement, l’agent est censé s’occuper des contrats avec la production. C’est hyper agréable, car c’est toujours compliqué de négocier surtout avec des prods qu’on ne connaît pas,. Je ne sais pas du tout faire, et je me suis beaucoup fait avoir… Par exemple, c’est mon agent qui m’a expliqué que comme je cadre aussi mes films, il fallait que je négocie en plus un demi salaire de cadreur. Je ne savais pas ! Mais son argument, à raison, c’est que si la production engage un cadreur, elle va bien devoir le payer ! Si tu fais deux postes payés pour un, la production fait des économies. Mon agent m’apporte aussi de la crédibilité auprès des producteurs et des réalisateurs. Ça rassure, ils se disent que vu que je suis en agence, je dois savoir bien bosser, etc. Mon agent peut aussi m’apporter des projets, mais ce sera peut-être dix pour cent de mon activité. La plupart de mes projets, je les décroche grâce à mon réseau. C’est aussi un peu une maman, quand ça va pas tu l’appelles. Quand ça va, tu l’appelles aussi, tu donnes des nouvelles. C’est un métier solitaire. Les assistants caméras sont plusieurs, ils peuvent échanger entre eux. Nous, on est tout seul. Pouvoir parler avec quelqu’un de ses angoisses et de ses interrogations, c’est toujours important.
Pourquoi cadres-tu tes films ?
C’est venu naturellement. On ne m’a jamais proposé d’engager un cadreur, parce qu’en général y’avait pas assez de sous… Donc je me retrouvais à cadrer. Et j’aime énormément cadrer, plus que de faire la lumière. Le cadre, c’est le dernier outil qui te permet de rendre ta lumière belle. Tu sais comment tu as éclairé une scène, tu sais comment tu vas la filmer. Au cadre, tu vas aller jouer avec ce que tu as fait en lumière, ce que tu as travaillé avec les costumes et la déco. Tu sais exactement comment le faire. Mais avoir un cadreur te permet de te reposer, de prendre plus de recul par rapport à l’image que tu fabriques. C’est deux façons différentes de travailler. Il faut aussi que le cadreur ou le steadycamer comprenne la grammaire du film, comment ça se passe. Ça fait un cerveau en plus qui lui aussi à des idées. Ça peut ralentir le process mais ça peut aussi amener plein de nouvelles idées
En 2021, est-ce qu’il faut absolument avoir un compte Instagram pour être chef op ?
Le mien n’était pas du tout à jour… Je réfléchissais à le renouveler, car je voyais de plus en plus de chefs opérateurs avec leur compte Instagram et leur petite vignette extraits des films qu’ils faisaient. Et un jour, une maquilleuse avec qui j’avais travaillé et qui est très présente sur les réseaux sociaux, m’appelle en me disant qu’elle a consulté mon compte Instagram avec un réalisateur qu’elle voulait me présenter et que ça n’allait pas du tout ! Elle m’a vraiment poussé à l’actualiser, ce que j’ai fini par faire… Mais c’est un choix personnel. Si tu travailles bien, que tu as un bon réseau et que tu es sûr de toi, tu n’as pas besoin d’avoir un compte Instagram. J’ai des amis chef opérateur qui ne sont sur aucun réseau social, et qui enchaînent les films. Ils ont une réputation qui n’est plus à faire.
Qu’est ce que tu conseillerais à un(e) jeune satisien (ne) voulant devenir directeur de la photographie ?
De faire les bonnes rencontres et d’entretenir son réseau. Surtout ne pas négliger les gens de sa génération. On travaille par génération, et c’est important de créer des choses avec les gens qui t’entourent, avec qui tu partages tes études et le cinéma. Il y a deux voies : celle de l’assistanat, et celle de commencer chef opérateur avec des petits projets. Ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. C’est une erreur que j’ai faite et que tous les jeunes chefs op font. Se dire que c’est bon, on est chef opérateur, on sait comment faire les choses. Alors qu’en fait, on est encore très vert et on a beaucoup de choses à apprendre. L’important, c’est l’humilité et la diplomatie !
Quel impact a eu l’épidémie de Covid-19 sur les tournages ?
Dès la fin du premier confinement, j’ai senti que tout le monde voulait tourner, parce qu’ils savaient qu’une deuxième vague risquait d’arriver et qu’il fallait vite tourner les projets avant celle-ci. Il y a eu une espèce de rush de l’été et de la rentrée, où j’ai fait un film avec Alexandra Lamy et Philippe Katerine en partie tourné à Marseille, de septembre à novembre. Ça a été galère pour le matériel et les moyens humains, car ça tournait dans tous les sens. Tout le monde souhaitait tourner vite, avant les fêtes et avant l’hiver, pour pouvoir partir en post production « tranquillement » et avoir des films en catalogue.
Sinon pour 2021, j’ai beaucoup de projets en vue : un film pour Canal +, une série pour OCS, un unitaire pour TF1 en mai… Ça tourne énormément. La question est : qu’est-ce qu’on va faire de tous ces films ? Il y a comme un bouchon de films en attente de sortie en salle. La télé et les plateformes ont besoin de contenus, qu’ils diffusent sur leur réseau. Mais pour le cinéma, on tourne sans savoir quand et comment les films vont sortir . C’est étrange.
Est-ce que tu as un souvenir particulier de tes années d’étude au Satis que tu souhaites partager avec nous ?
À mon époque, l’école avait un seul kinoflo. C’était LE projecteur du parc de matériel, le truc le plus cher. Jean-Pierre (NDLR : responsable du parc matériel) m’avait dit de vraiment en prendre soin. Et pendant le tournage, je l’avais installé pour faire un effet néon crade de salle de bain, avec de la gélatine verte, etc. Et pour avoir l’effet clignotant qui va bien avec, j’allumais et j’éteignais le ballast frénétiquement pendant les prises… Sauf que personne ne m’avait dit qu’il ne faut jamais faire ça ! Si bien que j’ai grillé le ballast. Je l’ai ramené à Jean-Pierre tout penaud. Mais l’équipe pédagogique ne m’a pas tellement engueulé. Leur discours était plutôt : « bon ben tu testes des choses, tu apprends, c’est bien… »
Entretien réalisé par Clément Allemand à distance, en janvier 2021.